guerre d'Algérie (1954-1962)

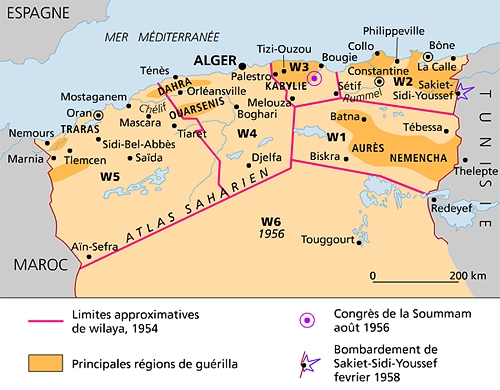
Conflit qui opposa, en Algérie, les nationalistes algériens au pouvoir d'État français.
La guerre d'Algérie, menée par la France de 1954
à 1962 contre les indépendantistes algériens, prend place dans le
mouvement de décolonisation qui affecta les empires occidentaux après la
Seconde Guerre mondiale, et notamment les plus grands d'entre eux, les
empires français et britannique.
Quand l'insurrection est déclenchée, l'indépendance
du Viêt Nam vient d'être arrachée – les forces françaises ont été
défaites à Diên Biên Phu,
ce qui constitue un encouragement pour tous les peuples colonisés.
Quant à l'indépendance des deux protectorats maghrébins, le Maroc et la
Tunisie, elle est en cours de négociation.
Cette guerre – que, jusqu'en 1999, l'État français
s'obstina à ne désigner officiellement que par les termes d'« opérations
de maintien de l'ordre » – allait apporter, après maints déchirements
entre opposants réformistes et nationalistes, l'indépendance au peuple
algérien. Elle allait aussi traumatiser durablement la société
française : le soulèvement des nationalistes algériens frappait un pays à
peine remis de la guerre ; il allait durer huit ans et finir par
emporter la IVe République.
1. L’Algérie à la veille de la guerre
1.1. Le symbole de la puissance française
Pour la France des années 1950, la perte éventuelle de l'Algérie représentait une atteinte à son rang de grande puissance, symbolisé depuis la fin du xixe siècle par sa présence coloniale dans le monde.
L'Algérie, au cœur du Maghreb,
entre Afrique noire et Proche-Orient, est la pièce maîtresse de son
dispositif. L'apport de la colonie algérienne à l'économie nationale,
longtemps limité à une agriculture commerciale dynamique, s'est
transformé grâce aux découvertes de pétrole et de gaz qui se multiplient
après 1951. L'Algérie constitue également la seule colonie française de
peuplement, avec un million d'« Européens » en 1954 (des Français, mais
aussi des Italiens, des Espagnols et des Maltais, qui bénéficient de la
naturalisation automatique), dont les avantages sont à opposer à la
sous-administration et au sous-équipement de la population musulmane.
1.2. L'insatisfaction de la population musulmane
Celle-ci, forte de neuf millions d'habitants, de statut coranique, en forte croissance démographique, est en partie réduite à la misère par la crise agraire.
Pour les Algériens, la lutte armée sert à exprimer
une désillusion réelle à l'égard des promesses françaises. En 1937, le
projet Blum-Viollette étendant le droit de vote à une minorité de
musulmans a été repoussé. En 1947, un nouveau statut organique est
octroyé, créant une Assemblée algérienne dont la moitié des
représentants est élue par un collège de 522 000 citoyens français, et
l'autre moitié par un collège de 1 200 000 musulmans non citoyens. Mais,
dès 1948, le vote du collège musulman est truqué par le gouverneur
général Naegelen appuyé par l'opinion pied-noir (nom usuel de la
communauté française d’Algérie) et donne la majorité aux candidats
musulmans de l'administration française.
Pour en savoir plus, voir l'article colonisation.
1.3. Diversité du nationalisme algérien
En 1954, le mouvement nationaliste algérien, déjà ancien, est en pleine mutation. – L'Association des oulémas (docteurs de la loi islamique) garde une autorité surtout morale.Les anciennes formations
– L'Union démocratique du manifeste du peuple algérien (UDMA), fondée en 1946 par Ferhat Abbas, a soulevé les espoirs de la bourgeoisie musulmane, mais elle est la principale victime de la politique du gouverneur général.– Le parti communiste algérien hésite entre autonomie et assimilation.
– Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) de Messali Hadj, fondé en octobre 1946, est le fer de lance du nationalisme algérien. Il s'impose grâce à son programme – l'indépendance totale – à ses 25 000 militants aguerris par la clandestinité, et aux révoltes menées par le parti populaire algérien (PPA, interdit depuis 1939, auquel le MTLD sert de couverture légale ) dans le Constantinois en 1945.
La fondation du FLN (1954)
Toutefois, l'autorité de Messali Hadj est contestée par ceux – dont Hocine Aït Ahmed et Ahmed Ben Bella – qui préconisent l'action immédiate pour relancer le mouvement et qui créent en mars-avril 1954 Le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action (CRUA).
En octobre 1954, neuf personnalités – parmi lesquelles Aït Ahmed, Belkacem Krim, Ben Bella, Mohammed Boudiaf, qui traverseront toute la guerre – fondent le Front de libération nationale (FLN), le dotent d'une Armée de libération nationale (ALN), et fixent l'insurrection pour la Toussaint 1954.
2. La guerre de 1954 à 1958
2.1. Guérilla contre armée traditionnelle

L'année 1955 marque un tournant : le recours à la
force est prôné par F. Mitterrand qui présente un programme de réformes
pour l'Algérie. Les premières opérations de l'armée française se
déroulent dans l'Aurès. Jacques Soustelle, nommé gouverneur général de l'Algérie prône l'intégration et le gouvernement français instaure l'état d'urgence (1er avril).
Les opérations menées relèvent de la guérilla : attentats, attaques de
détachements, sabotages, d'abord en Kabylie et dans le Constantinois.
2.2. Le soulèvement dans le Constantinois (août 1955)
Les 20 et 21 août 1955, des émeutes éclatent au Maroc (le 20 août est la date anniversaire de la déposition du sultan Sidi Mohammed ben Youssef, champion du mouvement nationaliste) et en Algérie. Il s'agit de prouver la solidarité des combattants algériens avec les autres luttes du Maghreb, mais aussi de montrer la capacité politico-militaire du FLN. Le bilan des émeutes est de 123 morts, dont 71 Européens, mais la répression qui s'ensuit est disproportionnée, avec un nombre de victimes peut-être supérieur à 10 000 (le chiffre officiel étant de 1 273 morts).
Ce drame coupe de façon irréductible les liens entre les deux communautés.
2.3. La généralisation de la lutte armée (1956-1957)
Le 12 mars 1956, l'Assemblée nationale vote les pouvoirs spéciaux au gouvernement Guy Mollet : la décision de recourir à l'armée marque un tournant dans le dispositif répressif du maintien de l'ordre. Il est fait appel au contingent : 450 000 soldats français (contre 25 000 combattants algériens).
À partir de 1956, la lutte armée se déroule sur tout
le territoire, grandes villes comprises. Le poids du commandement
militaire ne cesse de croître. Il est confié à des officiers chevronnés,
comme le général Salan,
commandant en chef en novembre 1956, puis délégué général du
gouvernement en mai 1958, avec tous les pouvoirs civils et militaires.
Son successeur, le général Maurice Challe (décembre 1958-avril 1960), et le général Massu,
qui manifeste sa vigueur lors de la « bataille d'Alger » en 1957, sont
populaires parmi les pieds-noirs. Certains officiers plus jeunes
s'engagent totalement dans la cause de l'« Algérie française ».
2.4. La création du GPRA (1958)
Côté algérien, l'ALN dispose dans chaque wilaya, ou région militaire, d'un double commandement, militaire et politico-administratif, sous la direction d'un colonel. Des tensions apparaissent avec les combattants de l'extérieur, mais le principe d'une direction collégiale est acquis lors du congrès de la Soummam, en août 1956.
En 1958 est créé à l'extérieur un Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), présidé jusqu'en 1961 par Ferhat Abbas.
Du côté du FLN, rivalités internes, purges sanglantes
et disparitions au combat provoquent un renouvellement partiel des
dirigeants (Houari Boumediene devient chef de l'état-major général de
l'ALN en 1960).
2.5. Une victoire impossible pour l'armée française
La France finit par gagner la guerre sans pour autant rétablir l'ordre. À partir de 1957, le contrôle est repris dans les grandes villes (« bataille d’Alger »), sur les frontières (1957-1958), puis dans les campagnes, par étapes, jusqu'en Kabylie (1959-1960), grâce à la pratique des « camps de regroupement ».
En revanche, la France perd la guerre auprès de
l'opinion, internationale et métropolitaine. Auprès des musulmans,
l'« action psychologique » a échoué : les regroupements forcés, les
exactions de l'armée française et la terreur entretenue par le FLN
rendent toute cohabitation impossible.
2.6. Un conflit de dimension internationale
L'aide des pays arabes au FLN
Malgré les tentatives des gouvernements français de présenter la guerre d'Algérie comme un problème de police intérieure, la dimension internationale du conflit n’a cessé de croître, ce qui a profité au FLN. L'aide arabe a été décisive. La Délégation extérieure du FLN s’est regroupée autour de Ferhat Abbas au Caire, siège de la Ligue arabe.
Les deux pays voisins, le Maroc et la Tunisie, ont
servi d'arsenal, de base arrière et de camp d'entraînement pour les
combattants. Chaque tentative de l'armée française pour rompre la
solidarité de ces États souverains a soulevé des protestations
internationales, que ce soit lors de l'interception, en 1956, d'un avion
marocain transportant des chefs historiques du FLN (dont Ben Bella), ou
lors du bombardement du village tunisien de Sakhiet Sidi Youssef le
8 février 1958, qui a suscité la réprobation américaine.
L'hostilité des deux Grands face à la France
Les deux Grands ont en effet condamné la politique française au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais pour des intérêts contraires : l'URSS a vu dans son soutien mesuré au FLN le moyen d'implanter son influence au Maghreb ; les États-Unis ont considéré que l'intransigeance française était le meilleur moyen pour que l'URSS y parvienne.Le soutien des pays non-alignés au FLN
En permettant à la délégation algérienne de siéger dans leur mouvement comme membre à part entière lors de la conférence de Bandung, les pays non alignés donnent une dimension internationale au FLN. À partir de septembre 1955, les offensives diplomatiques répétées des pays afro-asiatiques contraignent la France à justifier sa politique devant l'Assemblée générale des Nations unies d'abord en 1956, puis à nouveau l'année suivante.3. La France malade de la guerre d'Algérie (1956-1958)
3.1. L'agonie de la IVe République
L'impuissance du régime
L'impuissance de la IVe République à rétablir la paix est exploitée par la coalition provisoire des forces politiques qui lui sont hostiles et aboutit à l'effondrement du régime.
Face à l'échec de la politique d'intégration menée
par Soustelle à partir de 1955 et face au refus des propositions
françaises (cessez-le-feu, élections, négociations) par le FLN, les
gouvernements hésitent entre la négociation à tout prix et la guerre à
outrance. Ils laissent de plus en plus l'initiative politique à l'armée
et à la rue : le 6 février 1956, des tomates sont lancées sur le
président socialiste du Conseil Guy Mollet, qui rappelle le gouverneur général, le général Georges Catroux, et nomme à sa place Robert Lacoste comme ministre résident.
Les divisions déchirent les partis, provoquent la
rupture de la majorité de Front républicain au pouvoir depuis janvier
1956, et le retour à l'instabilité ministérielle des législatures
précédentes, après la chute de Guy Mollet le 21 mai 1957.
Le 13 mai 1958
Cette impuissance est exploitée à Alger, parmi les colons, par des activistes qui cherchent à provoquer un putsch qui contraindrait Paris à poursuivre la guerre. Ils rejoignent ainsi les préoccupations de nombreux officiers, de plus en plus méfiants à l'égard du gouvernement civil, et qui assimilent négociations et « trahison » des combattants.
Le 13 mai 1958, des manifestants, animés par le
président des étudiants d'Alger, Pierre Lagaillarde, investissent le
siège du gouvernement général et désignent un « Comité de salut public »
dirigé par le général Massu, avec l'accord du général Salan.
À Paris, la nouvelle de la rébellion d'Alger éclate
comme une bombe : le nouveau président du Conseil, Pierre Pflimlin,
tente de préserver la légalité. Mais dès le lendemain, Massu lance un
appel au général de Gaulle, franchissant un nouveau pas dans la rupture
avec Paris.
Pour en savoir plus, voir l'article crise du 13 mai 1958.
Le retour du général de Gaulle
Le 15 mai, le général de Gaulle se dit « prêt à assumer les pouvoirs de la République », mais sans préciser davantage quelle politique il entend mettre en œuvre en Algérie.
L'arrivée de Jacques Soustelle (rallié à de Gaulle) à
Alger le 17 donne un chef politique au mouvement né du 13 mai, tout en
aggravant le différend avec la métropole. À Alger toujours, des
émissaires gaullistes officieux prennent contact avec les factieux.
Le pouvoir exécutif est paralysé par la menace d'un coup d'État militaire. Pflimlin démissionne le 28. Le président René Coty fait alors appel au général de Gaulle. Le 1er juin,
l'Assemblée nationale l'investit avec tous pouvoirs pour élaborer une
nouvelle Constitution. Le 3 juin, de Gaulle obtient les pouvoirs
spéciaux pour six mois afin de résoudre la crise algérienne. Le
lendemain, à Alger, il lance son « Je vous ai compris ! ».
Pour en savoir plus, voir les articles général de Gaulle, IVe République.
3.2. La recherche de la paix (1958-1962)
De Gaulle, de l'intégration à l'autodétermination (1958-1959)
La rupture de l'opinion française avec les pieds-noirs et l'armée d'Algérie est un temps masquée par la politique du général de Gaulle (fin 1958, le « plan de Constantine » suggère une politique d'intégration). Mais, le 16 septembre 1959, l'annonce de l'autodétermination fait monter en première ligne les partisans de l'Algérie française.
Dans un discours décisif, de Gaulle propose trois
voies, entre lesquelles les Algériens seront appelés à choisir :
sécession, francisation ou association. C'est la première fois que
l'indépendance peut être, de fait, envisagée. Reste cependant le
problème de la pacification de l'Algérie, sans laquelle
l'autodétermination est improbable.
Un pays favorable à la paix
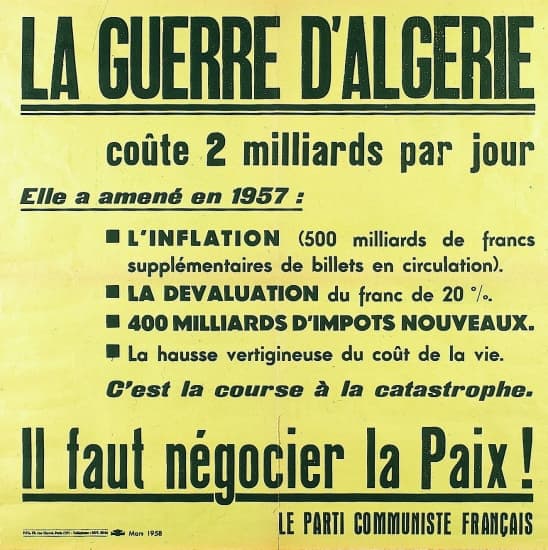
L'utilisation pour la guerre d'Algérie de soldats
appelés du contingent a installé le conflit au cœur des familles ; le
FLN intensifie les attentats, la métropole n'est plus épargnée. La
répression ne faiblit cependant pas, comme lors de la manifestation des
Algériens à Paris le 17 octobre 1961, qui fait plus de 200 morts selon les sources officielles divulguées en 1997.
En outre, le coût économique de la guerre ébranle une
partie de la classe politique et les milieux d'affaires, qui voient
avec inquiétude les pays concurrents se moderniser et connaître une
forte croissance. Enfin, le coût moral de la guerre et le mépris pour
les libertés républicaines que semblent avoir l'armée et le gouvernement
poussent divers acteurs à entrer en action.
La mobilisation pour la paix
Les intellectuels se mobilisent, les uns pour les libertés, les autres pour l'indépendance algérienne (Manifeste des 121
en faveur de l'insoumission, septembre 1960). À Alger, quelques isolés
prônent le rapprochement des communautés, tels André Mandouze ou Albert Camus. Rares sont ceux qui aident, clandestinement, le FLN, tels les « porteurs de valise » du réseau Jeanson.
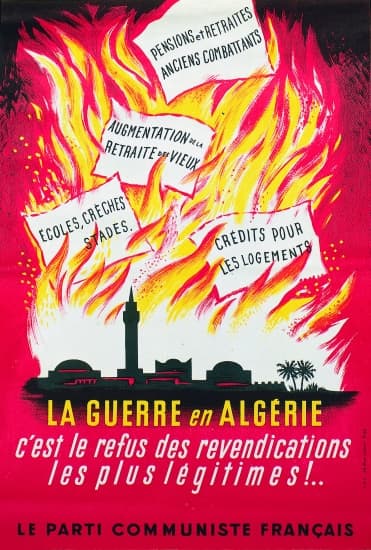
Quelques journaux – France-Observateur, Témoignage chrétien, le Monde –, bravant la censure et les poursuites judiciaires, dénoncent la torture. Le syndicalisme étudiant (→ Union nationale des étudiants de France)
passe du refus de la guerre au soutien à l'indépendance. Une partie des
syndicats ouvriers et des militants politiques de gauche – parti communiste à partir de 1956, parti socialiste autonome, mendésistes, puis parti socialiste unifié – manifestent contre la poursuite des combats, puis pour le soutien aux négociations.
Le 8 février 1962, une manifestation organisée par
les syndicats de gauche contre l'OAS est durement réprimée par la
police. La bousculade qui s'ensuit cause la mort de neuf manifestants au
métro Charonne, dans le XIe arrondissement de Paris.
3.3. De la semaine des barricades aux accords d’Évian (1960-1962)
Les derniers sursauts de l'Algérie française
L'épreuve de force éclate lors de la « semaine des barricades » (24 janvier-1er février 1960), avec la complicité de certaines unités de l'armée, mais le général Challe, commandant en chef, bloque l'insurrection.
Cependant, dès l'année suivante, la perspective de
l'aboutissement des négociations entamées à l'automne 1960 avec le FLN
et de la reconnaissance d'un État algérien souverain fait basculer
Challe ainsi que les généraux Salan, Zeller et Jouhaud dans la rébellion.
Mais le putsch d'Alger
(21-26 avril 1961) échoue, faute de rallier le contingent et l'opinion
française. Les officiers factieux rejoignent alors l'OAS.
Impuissante à empêcher l'indépendance, l'OAS
multiplie les attentats (en Algérie et en métropole), les destructions
systématiques et les massacres, comme la fusillade de Bab-el-Oued en
mars 1962. Les violences commises par l'OAS ne cessent qu'après l'accord
FLN-OAS du 17 juin 1962. Dans un tel climat de haine et de peur,
900 000 Français d'Algérie décident de quitter le pays, de se faire
« rapatrier » en France.
Commentaires
Enregistrer un commentaire